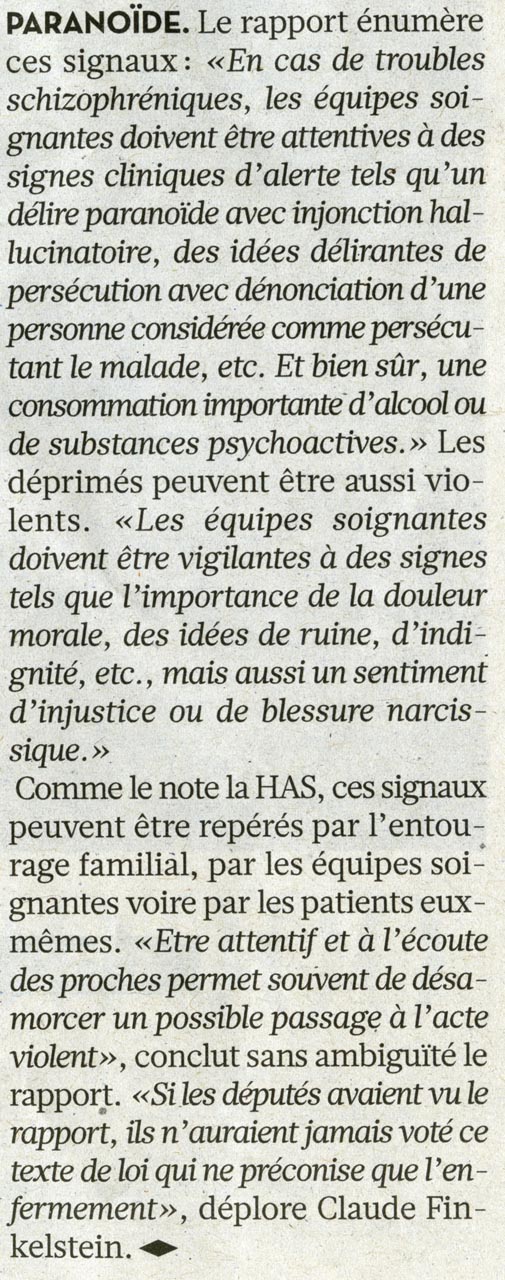Critique. De l’ennui au désespoir, les nuances du pessimisme par l’historien des idées Jean-Marie Paul. Par Robert Maggiori, Libération du jour.
«Chamfort disait : le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste attend qu’il change, le réaliste, lui, règle les voiles. Le premier «se trompe en voyant la vie plus noire qu’elle n’est», le deuxième «en la voyant plus rose». Il ne faudrait pas grand-chose pour que l’un se révèle un rabat-joie, et l’autre un jocrisse. Pourtant, le pessimisme fait tout pour avoir de la prestance, s’habille en noir et prend des tons prophétiques. Mais il lui manque quelque chose pour être une vraie vertu (ou un vrai défaut) : il s’arrête aux portes du désespoir ou de la dépression. Le définir s’avère malaisé, car il est moins une position fixe qu’une disposition de l’âme, une inclination à ne retenir de la réalité que les aspects négatifs, à penser, mais pas systématiquement, que le mal l’emporte sur le bien, que le monde est gouverné par une force impitoyable, ou que l’existence humaine est flétrie par le malheur et la douleur. Aussi est-ce dans les œuvres, picturales, musicales, littéraires, philosophiques qu’on en saisit au mieux les expressions. C’est l’optique que prend dans Du pessimisme l’historien des idées Jean-Marie Paul, qui concentre son étude sur le «pic» qu’a représenté le XIXe siècle («nous n’en sommes pas descendus depuis»).On ne sait s’il faut qualifier de pessimistes le cynisme, le stoïcisme ou le scepticisme antiques. Si elles apprennent à faire face, en créant l’«impassibilité en notre for intérieur», les philosophies grecques ont en tout cas exprimé l’idée d’une «inexorable adversité» sur laquelle les hommes désespèrent d’avoir prise. Cependant, seul Hégésias de Cyrène se montra vraiment pessimiste, qui, posant que le plaisir était le but de la vie humaine mais le pensant inaccessible, montra que seule la mort, tranquillité absolue, était désirable. À Rome, on citerait Lucain, le neveu de Sénèque. En Inde, ont toujours existé «une pensée et une religiosité profondément pessimistes». Le pessimisme n’est donc pas apparu avec le christianisme, «comme on a pu le prétendre à la suite de Feuerbach et de Nietzsche, en opposant la joie de vivre païenne, dionysiaque, et une culture de la souffrance à nous infligée par le Christ». Dans sa forme moderne (le terme est lancé par Coleridge en 1795), il naît en Allemagne, dans la période qui suit celles, enthousiastes, des Lumières et de la Révolution, lorsque, paradoxalement, prenait force la «religion du progrès». Au début fut le «pessimisme métaphysique» de Schopenhauer. À partir de lui, Jean-Marie Paul «écoute» les voix (Byron, Leopardi, Poe, Baudelaire, Dostoïevski, Ibsen, Kierkegaard…) dont le chœur exprime, du spleen à la mélancolie, de l’ennui au désespoir, du désenchantement au nihilisme, les mille nuances du «noir sentiment». Le XXe siècle des génocides et des totalitarismes le rendra tragique. Et aujourd’hui ? Peut-être est-on à l’«âge du hochet», ouvert par l’«usage de la haute technologie à des fins infantiles», mais il y a la «crise». L’optimiste pense qu’elle prendra fin bientôt, le pessimiste qu’on n’en sortira jamais. Et le réaliste… ne sait que penser.
Jean-Marie Paul, Du pessimisme, Encre marine, 284 pp., 35 €.
daté du 3 février 2013