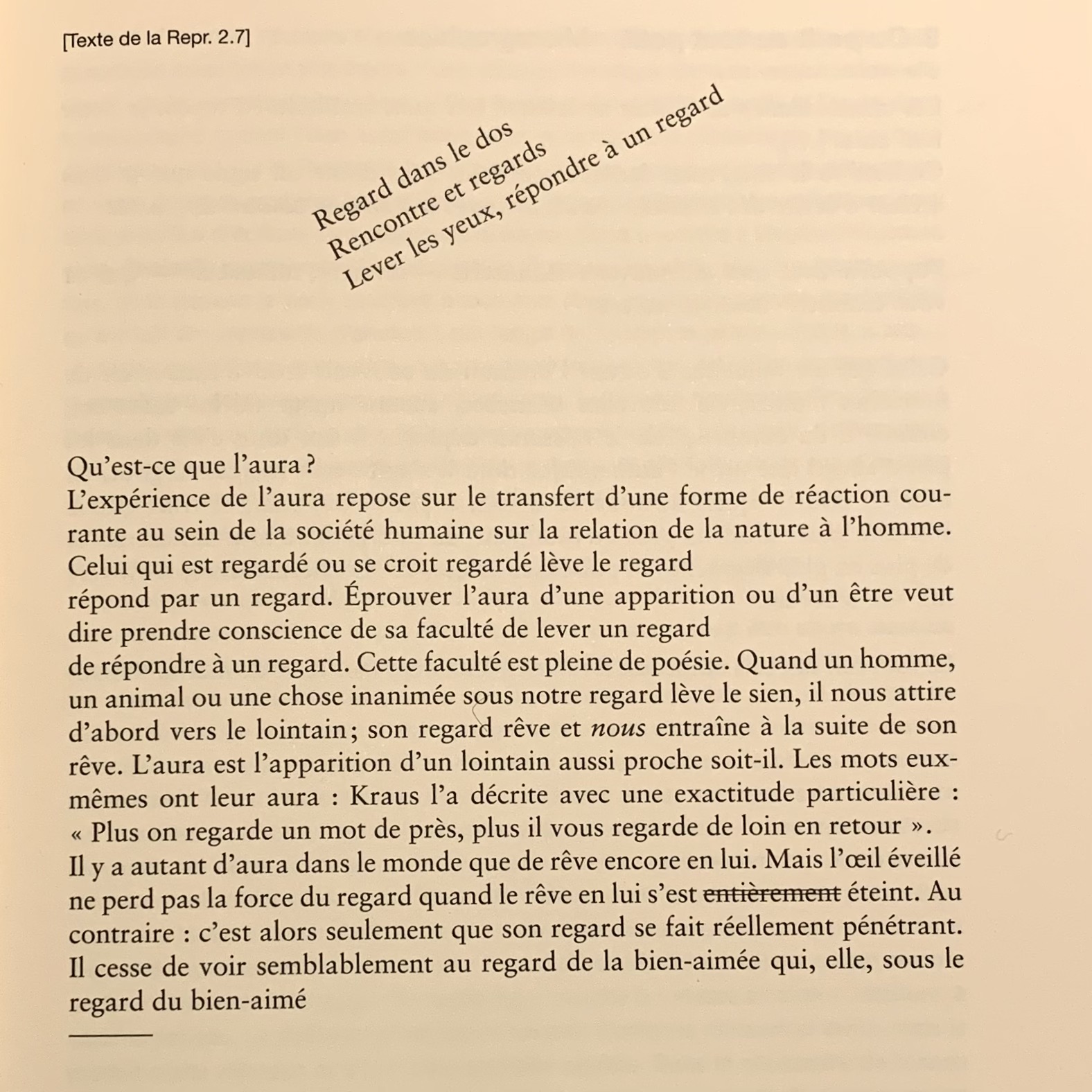Vous consultez actuellement Liliane’s articles.
Ketty La Rocca (1938-1976). Le mie parole, Mes mots, My Words, 1974. 10 photocopies et dessins montés sur carton, 10,5 x 50 × 35 cm. Florence, The Ketty La Rocca Estate. Vu et photographié dans l’exposition RENVERSER SES YEUX, AUTOUR DE L’ARTE POVERA 1960-1975 : PHOTOGRAPHIE, FILM, VIDÉO 11 OCTOBRE 2022 AU 29 JANVIER 2023 https://www.le-bal.fr/2022/09/renverser-ses-yeux
Biobibliographie sur le site AWARE https://awarewomenartists.com/artiste/ketty-la-rocca/
Les 10 photocopies
Le texte qui suit a été établi par moi, sous forme d’une suite de paragraphes citationnels, à partir de la retranscription de la communication de Jean-Louis Boissier «Toutes les copies» dans Les Immatériaux, 1985, Colloque Xérographie-Artistes femmes, 1965-1990, INHA, Paris, 18 et 19 novembre 202, Session 4/4, Pratiques curatoriales. Modération : Julie Jones, Centre Georges Pompidou (à paraître) que l’on peut retrouver ici: http://lantb.net/figure/?p=7412
« En 1985, l’exposition du Centre Pompidou, Les Immatériaux, a pu contenir une installation vivante, dédiée à la photocopie, comme technique, nouveau média et vecteur de création. Le site Toutes les copies a présenté la particularité d’une expérience collective propre à explorer une forme artistique performative et relationnelle, initié par une convention avec l’université Paris 8 « modalités émergentes de l’image dans l’art contemporain »: le multiple, la diffusion, portées par la photographie et la sérigraphie, le copy art, ouvert vers le réseau et la base de données, le relationnel programmé, l’interactif.
Le site Toutes les copies est « un cube transparent et suspendu, comme un bocal où vivent l’opérateur avec parfois un visiteur, des plantes, de petits animaux, entourés d’un grand nombre de matériaux, d’objets et d’images. Tous ces éléments, y compris le corps des manipulateurs, entrent en relation au même titre avec le petit copieur dit personnel, installé en son centre. Cette accumulation hétéroclite mais ordonnée par les choix de la copigénie peut apparaître comme une image globale, comme une collection à transformer selon un projet rationnel. Mais les copies contestent ces deux versions : elles sont des images toujours renouvelées et différentes. Faites à la demande, feuilles volantes, elles glissent depuis la fente du copieur, jusqu’au sol, hors du cube, en laissant son contenu intact, inchangé. »
« Comme son appareil copieur, le dispositif Toutes les copies, s’articule autour d’une vitre. Cette vitre est-elle vraiment transparente ? Le passage d’un côté à l’autre ne peut se faire que par une fente, avec une mise à plat. Cette dimension perdue, la profondeur, se réinvestit dans la durée. Ces deux caractères s’identifient à ceux de la feuille de papier : planéité et permanence. […] La photocopie confronte l’image à son modèle, sa matrice est l’apparence des choses elle-même. En copiant des objets, on en révèle le caractère de matériau pictural et d’image potentielle, de mise en écriture indéchiffrable, [la photocopie c’est du texte], alors que les images issues du copieur avouent leur existence d’objets. »
« Ce qui est installé, c’est plus que l’appareil et les objets, c’est une somme de savoir-faire, de procédures. Le choix des matériaux, et objets, et images, est le résultat d’un ensemble d’expériences. Une invention oriente ce travail : les objets ont un volume, le copieur n’a donc pas de couvercle, et le fond de l’image est clair malgré tout car un éclairage est placé au-dessus de la machine. »
« Les photocopies sont regroupées en quatre catégories, selon le mode de passage inframince qui se joue à la vitre-miroir.
1. Le plan est un support pour la disposition la mise à plat ;
2. Le plan est un support pour le développement;
3. Les choses sont déjà planes;
4. Les choses sont déjà des images.»
La photocopie, estampe électrographique, présente la caractéristique d’agir par monotypes : la copie va chercher sur l’original les paramètres de sa constitution. Pour se répéter, elle ne peut que s’y référer de nouveau. À la différence des procédés de gravure, […] la matrice se détruit à chaque transfert et doit se reconstituer à la source de l’original. La plaque photo électrique n’est qu’une matrice transitoire, c’est l’objet la véritable matrice. »
Exception dans Les Immatériaux, à l’adresse des visiteurs, il y a une notice : « Mode d’emploi du cube, avril 1985. Cinquante des objets, matériaux et images enfermés dans ce cube ont été photocopiés sur le petit copieur placé au centre de la nacelle, débarrassé de son couvercle et dans la plupart des cas éclairé par une lampe suspendue à la verticale du peigne de fibres optiques qui se trouve à fleur de la fente que vous apercevez à travers le plateau vitré mobile du copieur. Les cinquante photocopies obtenues sont affichées, face au cube. Mais ces copies d’objets et bien d’autres encore, peuvent aussi vous être fournies à la demande pendant les heures de fonctionnement du site par des démonstrateurs, étudiantes et étudiants en arts plastiques de Paris 8 : André Bénard, Denise Carel, Nanou Cauche, Christine Chabot, Christian Challier, Martine Delage, Brigitte Eymann, Françoise Fabian, Gaston Faihun, Fernando Gomez, Christian Laroche, Carole Lévêque, Hélène Munoz, Monique Petit, Catherine Savary, Viviane Soyer.
»
Donnons un aperçu des matériaux et objets présents [avril 1985]. Le plateau découpé d’un cercle où se trouvent le copieur et la personne est recouvert de sable; un oreiller chinois en forme de bébé y est couché ; une boucharde, rouleau destiné à imprimer un sol en ciment ; une taloche lisseuse ; un tamis ; un rabot et des bois taillés ; une peau de chamois ; un piège à souris ; des ressorts ; de la limaille de fer et des aimants ; des ampoules ; des épingles de sûreté ; des hameçons ; un herbier ; une icône grecque ; une photo de mariage ; des boîtes de Pétri avec des fossiles, des cailloux, des écorces, des lichens, des clous, des rivets, des bonbons et des dragées ; un bocal d’accessoires vestimentaires, tricot d’enfant, bavoir, gants ; un bocal de plumes ; un estampage chinois ; une fougère en pot ; de petites tortues vivantes ; deux marionnettes de théâtre d’ombres ; un boomerang ; un gruyère coupé ; un jambon suspendu ; des produits comme : aspirine, lait, thé, grenadine, encre de Chine, gouache blanche, glycérine, huile, liquide vaisselle, farine, eau ; etc.
« Matériau : ce sur quoi s’inscrit un message : son support. Il résiste. Il faut savoir le prendre, le vaincre. C’était le métier, faire une table avec un arbre. Qu’arrive-t-il si l’on conçoit, simule et réalise le matériau selon la nature du projet ? Toute résistance au projet d’inscrire un message serait vaincue. Le message ne rencontre pas son support, il l’invente. Le travail n’affronte pas son objet, il le calcule et le déduit. Évolution des métiers vers la conception et l’ingénierie informatique. Déclin de la valeur attachée au travail, à l’expérience, à la volonté, à l’émancipation. Essor de l’imagination combinatoire, de l’expérimentation, de l’essai. La question pressante : avec la perte du matériau, la destinée en chômage ? »
Un rapprochement vers la fiche « surface introuvable », qui est aussi classée dans « matière », sous le terme « profondeur simulée », apporte notre phrase de prédilection pour les copies :
« La perception d’une surface comme plane dépend de l’échelle d’observation. La représentation bi-dimensionnelle est conventionnelle. Dans toute surface se cache le relief de son matériau. »
Nous sommes dans l’une des 26 zones sonores attribuée aux sites, la zone sonore numéro 9 pour « Peinture luminescente », « Peinture sans corps », « Toutes les copies ». Le visiteur, le regardeur et éventuel « client » entend donc dans son casque des citations de Maurice Blanchot, d’Octavio Paz, d’Henri Michaux.
La présence d’une personne comme « pilote », et parfois d’une deuxième, « copilote », permet des comptes rendus hebdomadaires qui sont à part entière parties de la performance. Si la manifestation est une œuvre d’art, l’installation, et peut-être avant tout le cours qui la fait vivre, est une œuvre.
« Toutes les copies était le dernier site du premier parcours de l’exposition, situé à proximité de l’entrée du Labyrinthe du langage. Parallèlement, il fait partie de la zone audio numéro 9, avec les autres sites […] qui abordent […] les questions de paternité et de production automatique […] des images. Mais alors que d’autres sites de cette voie, dont « Infra-Mince », posaient ces questions à propos d’œuvres d’art, dans Toutes les copies l’arbitraire des objets photocopiés témoignait du fait que les images n’ont pas besoin d’être des objets d’art pour manifester l’insaisissable : « Tout peut être photocopié. […] Il peut en résulter quelque chose de méconnaissable », écrit Lyotard dans l‘Inventaire. […] En l’absence de tout jugement sur l’objet copié, la lumière est capable […] sans acte créateur, sans auteur, sans référent métaphysique, de produire une image […]. » « En contraste avec ces considérations conceptuelles se dressait le cadre plutôt banal du site […]. La rencontre directe avec une personne manipulant le photocopieur, était la seule occasion de toute l’exposition où l’isolement du visiteur était rompu. […] Ici, une véritable interaction était possible, même limitée par la vitre du cube. En contrepoint d’une production d’images […] automatisée, elle marquait un espace de rencontre et de jeu […]. » dit Antonia Wunderlich, Der Philosoph im Museum. Die Ausstellung Les Immatériaux von Jean-François Lyotard, Bielefeld, Transcript, 2008. Traduit de l’allemand par nous.
Devant le cube vitrine de « Toutes les copies », on demande une copie mais pas la chose. Mieux, processus déictique, on désigne la chose-matrice par son nom pour l’avoir imprimée, c’est-à-dire traduite. »
Liliane Terrier Installation « TOUTES LES COPIES » — cliquer sur l’image pour voir la vidéo*
de l’installation remontée et réactivée** dans l’exposition Matter. No Matter-Anti-matière. Expositions passées comme expériences numériques, 2022-2023 ZKM | Karlsruhe © ZKM I Centre d’art et de médias Karlsruhe.
L’exposition était à voir dans l’Atrium 1+2, 2ème étage de @Zkmkarlsruhe jusqu’au dimanche 23 avril 2023. https://zkm.de/en/exhibition/2022/12/matter-non-matter-anti-matter
* La Vidéo a été réalisée par Margit Rosen le soir du vernissage 2 décembre 2022 montée et mise en musique par elle, pour être publiée sur Instagram et sous-titrée : « The artist is present ». Marcella Lista a laissé un commentaire : « Liliane rocks ». Puis cette vidéo a été republiée sur Instagram par Livia Nolasco-Rozsas commentée : « …Representation is not everything but cheerful iconophilia (iconophilie joyeuse) is utterly essential. » Mon commentaire : « Goût de l’estampage et iconophilie. »
**Historique : « Dans le cadre du parcours « Matériau » de l’exposition Les Immatériaux (au Centre Georges Pompidou, 1985), un peu comme dans les sites « Inframince » 1 et « Surface introuvable » 2, « Toutes Les Copies » 3 explore le passage de l’objet à l’image en passant par la xérographie. La sélection et l’agencement des « matériaux-objets-images », également qualifiés de « copigéniques», leur placement sur la photocopieuse, le mouvement pendant le scan, le jeu des fonds et des reflets, l’éclairage et le réglage de la machine sont tous les processus tangibles qui sont présentés de la même manière que les photocopies et le dispositif lui-même. Ce dernier est conçu comme un « Vivarium », un espace d’expérimentation où de multiples interactions entre corps, objets et technologie peuvent avoir lieu. Pour Liliane Terrier, la xérographie est une forme d’estampage électrographique qui s’apparente à un monotype dans l’estampe traditionnelle. Contrairement aux procédés de gravure, le modèle électrographique est unique et spécifique à chaque transfert. Du fait du contact direct de l’objet avec la plaque photoélectriquement sensible et du transfert quasi immédiat sur le papier, cette technique a produit de nouveaux régimes d’image et est présente dans l’art depuis le début des années 1960. »
Ce texte-cartel de l’installation Toutes les Copies, paru sur instagram, associé ici à cette courte vidéo, dans sa version originale en anglais, présent dans la communication globale de l’exposition Matter. No Matter-Anti-matière. Expositions passées comme expériences numériques, 2022-2023, ZKM, a pour autrice Julie Champion Lagadec, attachée de conservation collection Nouveaux Médias, Mnam – Centre Pompidou : « In the context of the « material » path of the Les Immatériaux exhibition (@centrepompidou,1985), much like in the sites « Infra-mince » and Surface introuvable [Untraceable Surface], Toutes Les Copies explores the passage from object to image through the medium of xerography. The selection and arrangement of the « materials-objects-images », also referred to as « copigenetics », their placement on the copier, the movement during the time of scanning, the background and reflections, and the lighting and the adjustment of the machine are all tangible processes that are presented in the same way as the photocopies and the device itself. The latter is designed as a « vivarium », a space for experimentation where multiple interactions between bodies, objects and technology can take place. »
Les trois fiches recto verso princeps de l’installation Toutes les copies (catalogue Les Immatériaux 1985)
1 « Inframince » (fiche du catalogue Immatériaux 1985)
2 « Surface introuvable » (fiche du catalogue Immatériaux 1985)
3 « Toutes Les Copies » (fiche du catalogue Immatériaux 1985)
Verso de la fiche « TOUTES LES COPIES » : Conception, animation : Liliane Terrier et les étudiant.e.s de l’atelier » L’objet-matrice » Arts et technologies de l’image – département Arts Plastiques – Université Parie 8 : André Bénard, Denise Carel, Nanou Cauche, Christine Chabot, Christian Challier, Martine Delage, Brigitte Eymann, Françoise Fabian, Gaston Faihun, Fernando Gomez, Christian Laroche, Carole Lévêque, Hélène Munoz, Monique Petit, Catherine Savary, Viviane Soyer
Dispositif : Jean-Louis Boissier
*** Les photos officielles de l’installation « TOUTES LES COPIES » dans son environnement, faites et publiées par le ©ZKM et dont certaines depuis ont remplacé la vidéo sur Instagram.
En exergue :
« The Arcades Project est un recueil de notes et de textes inachevés de Walter BENJAMIN, rédigés entre 1927 et 1940 et publiés à titre posthume; l’auteur y évoque les passages couverts parisiens et leurs enfilades de boutiques. C’est en flânant dans ces passages que Walter BENJAMIN a mûri un de ses concepts les plus célèbres, incarné par la figure du « chiffonnier », dont il compare l’activité à celle de l’historien, qui glane des fragments du passé et élabore un récit commun à partir de ceux-ci. Selon Walter BENJAMIN, la tâche de l’historien est moins la découverte de vérités absolues que l’assemblage de ruines afin de créer une mosaïque vivante. La figure du chiffonnier est le trait d’union entre les artistes de cette exposition*, dont les pratiques artistiques procèdent également de ce double geste de collection et de montage. Comme le chiffonnier, ils se servent de matériaux du quotidien, s’approprient des anecdotes et des histoires réelles aussi bien qu’imaginaires. Les divers fragments issus de la récolte initiale sont transformés en peintures abstraites ou en objets sculpturaux, donnant une nouvelle vie aux formes et aux idées. Ces œuvres sont l’incarnation de l’idée chère à Walter BENJAMIN selon laquelle « le monde est présent dans chacun de ses objets ».»
Le site Toutes les copies, lieu d’une expérience en live de copy-art appliquée à une cohorte d’objets quotidiens rassemblés littéralement autour d’un copieur personnel dans un cube transparent installé dans un espace d’exposition, au vu et avec la participation du public, fut créé spécifiquement par un collectif d’une dizaine d’étudiants avec leur prof appartenant au département arts plastiques de l’université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, pour l’exposition Les Immatériaux, centre Pompidou, en 1985. Toutes les copies est entré dans les collections du musée du Centre Pompidou en 2022, et vient d’être réactivé, à la demande du Centre Pompidou, pour l’exposition* Matter. Non-Matter. Anti-Matter, au ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe, Sat, December 03, 2022 – Sun, April 23, 2023m
Photos de l’expérience, le 2 décembre 2022, jour du vernissage au ZKM, avec Liliane Terrier et Julie Champion Lagadec
Dimanche 28 novembre 2021, 15h-17h30, Théâtre de Gennevilliers, représentation d’Eraser Mountain >http://jlggb.net/blog7/eraser-mountain
Entretien avec Toshiki Okada à propos de son spectacle Eraser Mountain, au théâtre de Genevilliers. Reprise de ce texte publié dans un document de présentation. Propos recueillis par Barbara Turquier, mars 2020
https://theatredegennevilliers.fr/la-saison/programmation/eraser-mountain
«Question : Eraser Mountain semble être un tournant dans votre approche du théâtre. Quel était le point de départ de ce spectacle ?
Toshiki Okada : Il y a plusieurs années, j’ai visité la région qui avait été dévastée par le tsunami après le tremblement de terre de 2011. C’était la première fois que je m’y rendais, et j’ai été choqué de voir que cette zone était en chantier. Comme l’endroit est dangereux, ils rehaussaient le niveau de la terre de douze mètres pour parer un prochain tsunami. Pour réaliser ce projet, ils ont eu besoin de grandes quantités de terre, et certaines montagnes ont complètement disparu. Pour moi, ce chantier incarnait un mode de pensée très anthropocentrique. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu réfléchir à la manière dont le théâtre pouvait être moins anthropocentrique, parce que c’est au départ un art très centré sur l’homme.
Question : Comment cette prémisse a-t-elle influencé la conception de votre spectacle – qu’il s’agisse des histoires qui y sont racontées, de la scénographie ou du travail avec les acteurs ?
TO : Pour réaliser Eraser Mountain, j’ai commencé par réfléchir à la manière dont nous pouvions créer un théâtre des choses, et non seulement des humains. Comment des acteurs humains peuvent-ils collaborer avec des objets, plutôt que simplement les utiliser comme des accessoires ou des outils ? Cette relation aux outils et aux accessoires ressemble parfois à une relation de maître à esclave. J’aimerais trouver un rapport plus équilibré entre les deux.
Question : Les photographies du spectacle montrent une scène jonchée d’objets de tous ordres. Comment avez-vous travaillé avec Teppei Kaneuji pour la scénographie ?
TO: Au début de la création, j’ai décidé de faire appel à Teppei Kaneuji, qui réalise la scénographie, mais qui est surtout artiste et sculpteur. Je me suis dit que Teppei serait la bonne personne pour trouver ce nouveau rapport aux choses. Teppei et moi avons décidé de ne pas penser les objets comme un décor. Aucun objet sur scène ne devait représenter quelque chose. Je lui ai dit qu’il pouvait y mettre tous les objets qu’il voulait. Il n’avait pas à se préoccuper le moins du monde des histoires racontées dans les différentes scènes. Nous travaillions ensemble, mais sans nous préoccuper l’un de l’autre. Je créais la fiction, et dans le même temps, il plaçait les objets comme il le désirait.
Question : Peut-on dire qu’il utilise la scène comme il le ferait d’un espace d’exposition ?
D’une certaine manière oui, il réalise une sorte d’installation sur scène. Mais j’imagine que c’est un travail très différent pour lui de le faire dans un théâtre, par rapport à ce qu’il réaliserait en galerie.
Question : Êtes-vous intéressé par l’idée que les objets développent une sorte de vie propre, et que les humains se comportent comme des objets ?
TO: Oui. Une des choses qui m’intéresse, c’est de voir comment on peut faire disparaître la différence entre les humains et les objets*. Nous avons tenté de rendre l’état des acteurs « semi-transparent ». Nous utilisions ce mot « semi-transparent ». C’est étrange et difficile à expliquer, mais le concept a fonctionné. L’idée était en quelque sorte de disparaître, de brouiller la frontière entre les hommes et les objets.
Question : Avez-vous écrit le texte, ou travaillé à partir de matériaux existants ?
J’ai écrit le texte, mais c’est un peu différent d’une histoire. La pièce commence avec quelqu’un dont la machine à laver tombe en panne. Cela peut être un point de départ. Une machine qui tombe en panne, c’est ennuyeux bien sûr, mais cela peut aussi être une bonne occasion de trouver une manière différente d’être en relation avec les choses.
Question : Êtes-vous toujours intéressé par le langage familier et oral qui a marqué vos spectacles passés ? Comment avez-vous travaillé le texte avec les acteurs ?
TO : Je ne me concentre plus principalement sur l’écriture d’un texte dans ce style familier. Désormais ce qui m’intéresse, c’est plutôt de relier l’imaginaire des acteurs au texte qu’ils prononcent. Ma manière de collaborer avec eux a donc évolué. Ces derniers temps, elle vise à trouver et développer un imaginaire aussi intéressant que possible avec les acteurs. Du point de vue des mouvements du corps, l’imagination est importante parce qu’elle peut faire bouger le corps des acteurs. En d’autres termes, elle peut chorégraphier. Néanmoins, j’aime toujours écrire le texte en utilisant ce langage très familier. Une des raisons est que le langage ordinaire affecte les acteurs qui le parlent d’une manière particulière, que j’apprécie.
Question : Vos spectacles impliquent généralement pour les acteurs une chorégraphie gestuelle très spécifique, inspirée du quotidien. Quel vocabulaire gestuel avez-vous recherché pour Eraser Mountain ?
TO : Ce type de mouvements est toujours là, mais ce qui est différent dans Eraser Mountain, c’est l’adresse des interprètes, qui n’est pas conventionnelle. Nous avons essayé de ne pas avoir d’adresse directe des interprètes au public. C’est une autre manière pour nous d’essayer de trouver des alternatives à l’anthropocentrisme au théâtre – à un théâtre des humains dirigé vers des humains.»
Question : Comment la position du public en est-elle redéfinie ? Acquiert-elle une autre statut?
TO : Je ne sais pas. Le spectacle ne peut pas être présenté au public d’une manière directe, mais cela ne veut pas dire que le public n’est pas un public. Les spectateurs doivent expérimenter le théâtre différemment que d’habitude. Je pense que cela peut déclencher de nouvelles manières de penser. Au début, on peut se sentir exclu – mais au fond, ce n’est pas tant le fait d’être exclu que de ne pas être tout à fait au centre.
Question : Cette œuvre propose-t-elle aussi une critique ou un commentaire sur la société japonaise ?
TO : De mon point de vue, Eraser Mountain offre un commentaire sur des problèmes sociaux japonais. Comme je l’ai dit, la pièce est inspirée par le tremblement de terre de 2011. Mais elle est aussi très abstraite, donc peut-être que les problèmes sociaux précis ne peuvent pas être vus.»
* Dans Le Concept de nature (trad. Jean Douchement, Paris, Vrin, 1998), Alfred North Whiteread décrit la relation entre objets et événements d’une façon qui aurait trouvé un écho dans l’appréhension des tissus et techniques textiles chez Anni Albers : «Un objet est un ingrédient inclus dans le caractère d’un certain événement. En fait le caractère d’un événement n’est autre que les objets qui en sont les ingrédients et les manières par lesquels ces objets font ingression dans cet événement. Ainsi la théorie des objets est la théorie de la comparaison des événements. Les événements sont comparables seulement parce qu’ils conduisent à des permanences. Nous comparons des objets dans les événements chaque fois que nous pouvons dire : «C’est encore là». «Les objets sont les éléments dans la nature qui peuvent être encore.» (p.188)» cité dans Anni Albers, Du tissage, T’ai Smith, «Lire Du tissage, page 243, note 7. Isabelle Stengers résume l’usage du terme chez Whitehead de la manière suivante : « Le nom « événement » célèbre le « fait » que ce que nous discernons a toujours un au-delà. » (Penser avec Whitehead, une libre et sauvage création de concepts, p.60)
Colloque Xérographie-Artistes femmes, 1965-1990, INHA, Paris, 18 et 19 novembre 2021
Session 4/4, Pratiques curatoriales. Modération : Julie Jones, Centre Georges Pompidou
Contribution de Jean-Louis Boissier : « Toutes les copies » dans Les Immatériaux, 1985